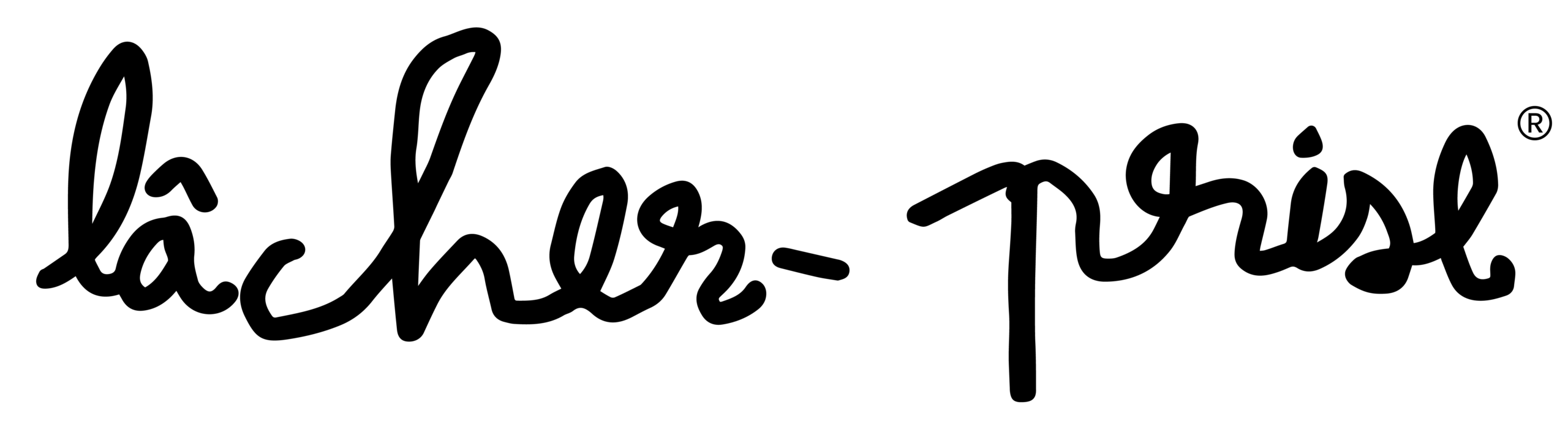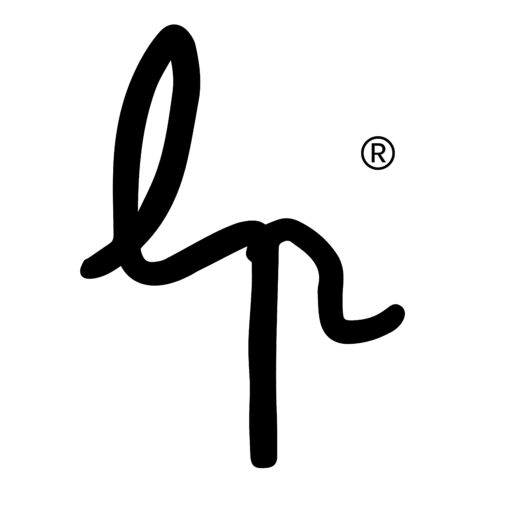Entre un sens et un autre, entre le “psy” et le “moteur”, entre le neurologique et le psychologique, entre maladies nerveuses et maladies mentales, la psychomotricité travaille les frontières.
La problématique psychomotrice est centrée sur l’importance d’un chassé-croisé entre interne et externe.
Deux postulats : on n’apprend pas la motricité + la motricité est portée par la relation.
Autonomie et potentiel :
Lors des séances, il s’agit de contribuer à l’intégration d’une fonction, de la plus motrice à la plus symbolique, en proposant une expérience nouvelle qui joue sur l’apprentissage et la découverte, mais surtout sur l’intégration.
Nous insistons sur le terme qui souligne le mouvement d’appropriation, d’assimilation, de mise à l’intérieur pour faire sien, d’appels aux forces du dedans. Il existe comme un paradoxe à contribuer à la mise en place de quelque chose qui ne peut s’apprendre que par soi-même, mais il est important de jouer avec ce paradoxe sans chercher à le résoudre.
Le cadre d’une thérapie tente de rassembler des conditions optimales pour qu’un cheminement, une prise de conscience, une révélation puissent avoir lieu.
Jouer, prendre soin, guérir :
Il est beaucoup plus souvent question de soigner et de prendre soin que de guérir.
Le jeu comme un soin ou le soin comme un jeu ?
Une activité organisée :
Une véritable base biologique de l’imaginaire permet d’expliquer le jeu comme une activité qui permet de jouer à vide des conditions appliquées plus tard à des objets réels.
Il n’est pas seulement une agitation, une dépense motrice incoordonnée, mais une véritable organisation de mouvements et de séquences psychomotrices, mentales et comportementales qui répondent à des scénarios plus ou moins élaborés, de l’image motrice à la fiction.
La psychomotricité se devait d’utiliser cette prédisposition au mouvement, cette intuition du corps et l’envisager comme une technique de soin.
Il s’agit de partir de ce que peut proposer l’enfant qui n’a pas toutes les capacités pour exprimer par le langage encore en développement chez lui.
Une fonction éternelle :
Il s’agit de résoudre des problèmes, de les déjouer et de se jouer du désagréable pour le transformer en supportable : exercer sa motricité et détourner ses peurs pour mieux les apprivoiser.
Au ressenti des émotions succède la symbolisation que jouer rend possible. Pour l’enfant plus âgé, le jeu devient indispensable au développement des capacités de socialisation. Jeux de rôles et jeux de règles priment et s’expriment. Tricher devient jouer avec les limites, contourner les règles pour mieux les situer.
Il aide l’adolescent à surmonter ses difficultés liés à la séparation ou à la confrontation, à l’apprentissage et aux fantasmes.
C’est tout au long de la vie que l’on retrouve le jeu, qu’il faille s’ouvrir à l’inattendu ou mettre du jeu dans les relations pour qu’elles soient plus vivables .